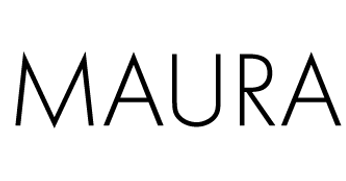| español | français

La peinture achève la réalité
La sépulture sous des couleurs qui n’existent pas, qui n’ont jamais existé.
Elle produit des femmes de feu sans famille, ni future, sans hommes. Des femmes faites pour danser, pour s’offrir à l’ardeur, à la température agitée rendu possible que par le souffle.
C’est pour cela qu’elles n’ont pas de visage, qu’elles ne souffrent pas, qu’elles ne parlent pas. Elles ne se confondent pas avec l’amour. Elles ne se rendent pas non plus dans les cafés et ne s’affaiblissent pas avec la pluie.
Les images de Maura mènent à un ruisseau de feu. Elles se rendent malades par une stridence neuve comme la fleur craintive, l’ombre dans le cristal rendu ou comme la blessure à la stridence passagère.
Sa peinture est une contagion, une divination et une sentence confinée dans le vice du gémir, du spéculer et du détachement des autres. C’est une trace, sur le mur, marquée par un amoureux. C’est un assassin qui arrive toujours à ses fins. Dans un territoire où bien et mal n’existent pas, l’art règne, brille et trompe, comme le fait n’importe quel arbre, l’homme qui prend naissance devant la grâce d’un cigare ou devant le regard d’une nana avec des écouteurs qui voyage dans le métro.
Quand le monde sera une torche allumée et solitaire et que les larmes rejoindront le feu, l’art ouvrira sa jupe et montrera le lac d’où provenait la beauté. Celui-ci sera le nom qui brûlait.
Les peintures baiseront la bouche des endormis. Les couleurs se dénuderont comme toujours. Et en vérité, cette bataille, cette danse durera jusqu’à ce que le corps puisse le supporter, c’est-à-dire jusqu’au cri, au délire qui dit amour, qui dit « viens, comment tu t’appelles ? »
II
Ceux qui sont venus avant ne savaient pas. Qu’allaient-ils savoir de cette lenteur, de cette fragilité de la danse, de ce rapprochement répandu. Ils ont apporté la culture, le vol baroque des télécommunications et la pâtisserie ardente qui s’approche des lèvres avec son pêché.
Le flamenco, le jazz sont les noms de sensations qui montent à l’imagination comme sur un bateau. Les coloris de la toile sauve le moribond. Ils lui disent : voici le chemin, allez vas-y. Et c’est ce que nous faisons. Nous sommes venus sans savoir et c’est ainsi que nous repartons. La peinture est un geste écarlate véhément qui tente l’inconnu, celui-là même qui s’offre noblement avec les seins, les hanches et le sexe, celui qui ouvre la porte pour que le paysage revienne et avec lui le corps d’avant, la femme et son souvenir d’or. Le vieux mouvement, la cadence, la séduction des figures sans visage, sa haute figuration, son énigmatique caresse, le vol resplendissant de son étonnement.
Edgar Liñán (Traduction Marco Magraner).
De Amatlán à Paris
L’œuvre de Maura Muñoz Ledo contient implicitement un élément invisible, une immanence divine : le temps. Inerte, dénuée d’attribut et cependant omniprésente, cette divinité nous procure jouissance et souffrance.
Dans sa peinture, sont présents, tels des messagers de l’incommensurable, la vitalité de l’eau, la couleur de la terre, la palette entière du feuillage des pruniers d’Amatlán et des châtaigniers de Paris, au milieu du murmure printanier et du silence éphémère. On y perçoit la fusion des chaudes lumières qui envahissent les espaces de la communauté mexicaine d’Amatlán, et la lumière ténue de l’univers parisien. Dans cette fusion des lumières à travers laquelle voyage l’artiste mexicaine, on peut découvrir la couleur des sentiers bordés de désir et de douleur, qui se développent dans ces espaces par l’enchaînement des actes humains. Maura Muñoz Ledo nous ouvre au présent par un nombre d’évènements, d’histoires imbriquées. Elle nous rend visible, au sein de chaque pli de la couleur, de nombreuses autres histoires cachées, nous invitant à nous rendre à l’évidence des espaces inondés d’existence qui ont une âme depuis qu’ils vivent par notre vue.
Enrique Arriola (Traduction Marco Magraner).